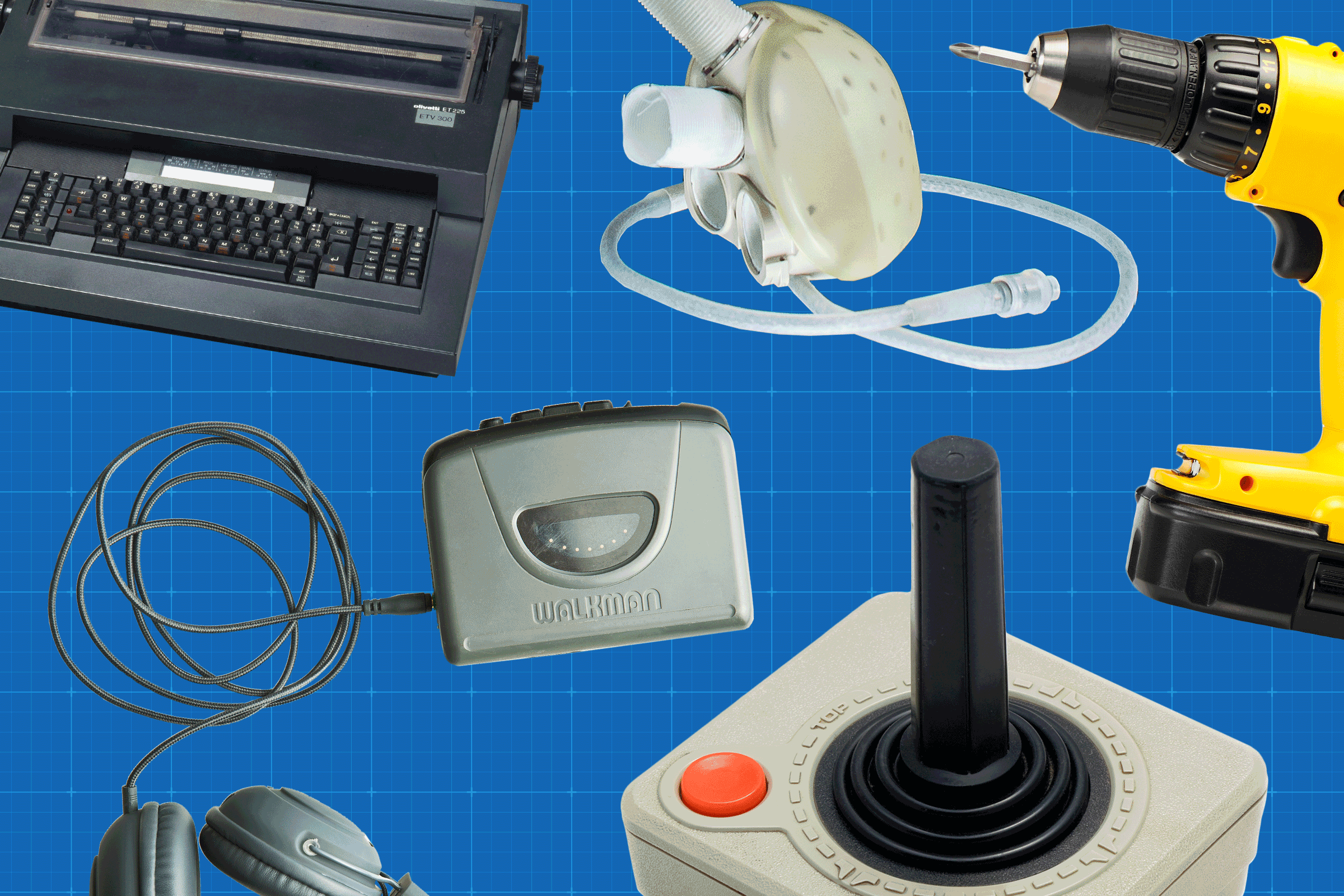Sarah Polley se connaît bien
Dans son nouveau film et un recueil d’essais, la réalisatrice, écrivaine et actrice observe le passé pour aller de l’avant.

Au milieu des années 1980, sur la moquette d’une salle de classe de Toronto, une ribambelle de petites têtes blondes de sept ans, coupe au bol, écoutent attentivement l’enseignante, Beverley Panikkar, faire la lecture du Lapin de velours. C’est l’un des livres préférés de Mme Panikkar, elle doit l’avoir lu des dizaines de fois. Pourtant, même aujourd’hui, elle est submergée par l’émotion, si bien que, lorsque des larmes ruissellent sur le museau duveteux du lapin, ses propres yeux s’emplissent également. Une voix monte alors du tapis à ses pieds. «Oh, Bev – viens t’asseoir. Je vais finir la lecture du livre!» Cédant sa place, l’enseignante s’assoit à l’arrière et écoute avec le reste de la classe, captivée, Sarah Polley, sept ans, poursuivre le récit.
Que nous apprend cet épisode de la vie de Sarah? Même à sept ans, elle possédait la troublante capacité de deviner les besoins et émotions des autres; son amour des histoires a commencé tôt; elle s’est sentie obligée d’intervenir et de prendre le rôle de l’adulte; son geste manifestait le caratère naturel d’une meneuse. Toutes ces interprétations sont bonnes, et pourtant, même toutes ensemble, elles ne révèlent qu’une partie de l’histoire.
Réalisatrice, écrivaine et actrice parmi les plus reconnues au Canada, Sarah Polley a bâti sa carrière en étudiant ses personnages avec une profonde curiosité et une intense empathie. Enfant-actrice, elle est inextricablement associée dans l’esprit collectif à Sara Stanley, la courageuse héroïne des Contes d’Avonlea, une série de CBC tirée de l’œuvre de Lucy Maud Montgomery.
Elle a également incarné à la télévision la fougueuse jeune fille des romans de Beverly Cleary, Ramona Quimby; elle est passée de l’autre côté du miroir pour interpréter Alice sur scène au festival de Stratford; et a joué dans des films comme Exotica, Une histoire d’initiation et De beaux lendemains quand elle était adolescente, donnant de la profondeur à des rôles qui auraient pu simplement répondre aux clichés de muse ou de martyre. Mais dès qu’elle l’a pu, Sarah Polley a cessé de jouer les personnages des autres et s’est mise à réfléchir à la manière de tracer sa propre voie.
L’année 2022 marque pour elle l’aboutissement de deux grands projets. La sortie en décembre de Ce qu’elles disent, son premier long métrage en tant que réalisatrice depuis 10 ans. Le film – adapté du roman à succès de Miriam Toew dans lequel des femmes d’une colonie mennonite débattent de la manière d’aborder une terrible trahison – a connu sa première mondiale au Festival international du film de Toronto en septembre. Et en mars, elle a publié son premier livre, Run Towards the Danger, six essais dans lesquels elle examine sa propre vie avec la même rigueur que les histoires qu’elle raconte à l’écran.
Un talent de famille
On peut dire qu’elle est tombée naturellement dans le cinéma. Ses parents travaillaient tous deux dans cette industrie: son père, Michael, était acteur avant de trouver un emploi plus stable dans les assurances à la naissance de ses enfants. Sa mère, Diane, était directrice de casting et également actrice. La jeune Sarah travaillait déjà comme actrice le jour où elle s’est levée en classe pour terminer la lecture du Lapin de velours. En 1985, l’année de son entrée en deuxième année, on pouvait la voir allongée sur un lit d’hôpital, pâle et angélique, dans un épisode du drame policier canadien Brigade de nuit. (Elle jouait une petite fille attendant désespérément une transplantation.)
Même à cette époque, elle savait qu’apparaître à l’écran n’était pas le but de sa vie. D’aussi loin qu’elle se souvienne, elle a toujours voulu écrire. Dans la classe de Mme Panikkar, elle concluait des accords avec son enseignante: elle travaillerait 15 minutes sur ses mathématiques ou s’engagerait à participer à la discussion d’études sociales après le déjeuner, si elle pouvait passer le reste du temps à écrire. Run Towards the Danger est dédié aux trois enfants de Sarah, mais également à Mme Panikkar.
Les livres ont toujours été l’une des grandes joies de sa vie. Élevée avec quatre frères et sœurs à l’esprit vif, plus âgés qu’elle de plusieurs années, elle débattait de littérature autour de la table dès l’enfance. Adolescente, elle étudiait des textes avec son père au beau milieu de la nuit. Lorsqu’elle repense à ses premiers souvenirs d’actrice, l’un des rares points positifs était d’avoir joué, à sept ans, dans la série canadienne Ramona, tirée des livres emblématiques de Beverly Cleary. Avoir la chance d’interpréter un personnage auquel elle s’identifiait si profondément a constitué son premier aperçu de ce que l’on pouvait éprouver en entrant dans une histoire pour l’incarner.
Vers 1988, alors que sa carrière prenait son essor, les sentiments ambigus que Sarah Polley entretenait envers son métier d’actrice s’accentuaient. Elle adorait Mme Panikkar et ses autres enseignants, et chaque nouveau projet la contraignait à passer beaucoup de temps hors de l’école, instaurant une distance toujours plus grande entre elle et ses camarades. «J’aimais l’école, affirme-t-elle. Je ne suis pas certaine que je ressentais la même sorte de joie sur les tournages que dans ma vie quotidienne.» En passant de plus en plus de temps sur les plateaux de tournage, elle découvrait également à quel point l’industrie du divertissement pouvait être toxique pour un enfant.
Le côté sombre du métier
Sa mère est décédée deux jours après son onzième anniversaire. Pendant longtemps, le traumatisme de cette mort a occupé une place fondamentale dans sa vie. Elle n’était pas consumée par ce drame, mais la perte de sa maman faisait partie d’elle. À l’âge de huit ans, elle avait déjà compris que sa mère était malade. Elle affrontait maintenant la réalité de sa mort.

L’une des premières fois où Sarah a pleuré pour sa mère a eu lieu devant la caméra, sur le tournage des Contes d’Avonlea. Elle raconte que plusieurs épisodes écrits à la hâte lui demandaient de pleurer la mort de sa propre mère – une tentative, pense-t-elle, d’exploiter son véritable sentiment de perte à l’écran.
Pour ne rien arranger, l’emploi du temps sur cette série était impitoyable, témoigne-t-elle, et l’ambiance sur le plateau était très dure. Dans un essai du recueil Run Towards the Danger, «Dissolving the Boundaries», elle décrit la cruauté ordinaire infligée aux enfants qui interprétaient les rôles secondaires, les techniciens forcés de travailler au-delà de l’épuisement, l’obsession malsaine qu’une personne sur le plateau avait développée pour elle. Personne n’est intervenu.
«Je pense que nous sommes tous devenus très doués pour paraître plus mûrs que nous l’étions mais, au fond, nous demeurions très jeunes et complètement perdus. Chez de nombreux anciens enfants acteurs, on observe une sorte de jeu de rôle précoce consistant à faire semblant d’être un adulte, qui malheureusement ne disparaît pas toujours avec le temps, et il demeure à l’intérieur quelque chose d’atrophié qui n’a jamais pu grandir.»
Dans Run Towards the Danger, Sarah Polley dit avoir été hantée par cette période de sa vie lors de vacances en famille avec ses trois enfants à l’Île-du-Prince-Édouard. De retour dans l’île, des souvenirs d’une visite promotionnelle durant laquelle elle avait été assaillie par une horde de fans ont ressurgi. Elle est à la fois soulagée et légèrement troublée de se rendre compte qu’aujourd’hui, des décennies plus tard, personne ne la reconnaît.
«Je pense que j’ai toujours désespérément voulu une vie normale, dit-elle. J’ai eu la chance de ne pas être très ambitieuse. On pourrait croire qu’il s’agit là d’une qualité élégante et humble, mais c’est aussi le résultat d’une vie privilégiée, n’est-ce pas? J’ai grandi entourée par l’art; j’ai eu une carrière avant même de pouvoir imaginer en vouloir une. Je pense que cette qualité, chez moi, peut paraître plus admirable qu’elle ne l’est vraiment. Je la tire d’une position privilégiée dans laquelle je rêvais d’échapper à une vie que de nombreuses personnes rêvaient de mener.»
Se servir de ses traumatismes
En psychanalyse, un traumatisme peut être considéré comme un événement auquel le sujet a été incapable de répondre sur le moment ressurgissant ensuite au cours de sa vie (Sigmund Freud), ou comme une sorte d’histoire de vie qui marque la personne traumatisée de manière permanente, un événement inattendu venu fracasser la surface de la signification, laissant sa victime buter sur les mots (Jacques Lacan).
Ces deux interprétations peuvent s’appliquer au processus artistique de Sarah Polley dans Run Towards the Danger, dans lequel chaque essai est librement inspiré d’un incident traumatique.
Au centre de l’essai qui donne son titre au recueil se trouve un terrible accident. En 2015, dans un YMCA du centre de Toronto, un extincteur de taille industrielle heurte la tête de Sarah. À la suite de cette blessure, elle a passé presque quatre ans dans un état intermittent de faiblesse et de confusion. Elle a fini par retrouver son équilibre avec l’aide d’un spécialiste américain des commotions cérébrales, dont le conseil peu orthodoxe – faire face activement à tout ce qui cause de la douleur – est devenu une sorte de principe directeur.
Elle a remarqué quelque chose chez les gens qui n’ont pas vécu de traumatisme. Ils pensent que toutes les personnes qui sont passées par là sont blessées, qu’elles ne peuvent pas avancer, qu’être brisées fait partie intégrante de leur identité. «Je pense que je commence enfin à me dire que, à moins d’avoir vécu un traumatisme et dû le surmonter, je ne suis pas sûre que l’on soit complet», me confie-t-elle.
«Je ne pense pas que l’on doive chercher à vivre un traumatisme! Mais s’il se produit, je ne pense pas non plus que cela soit le signe de dégâts permanents. Je crois que si l’on intègre son traumatisme d’une manière qui a du sens, il nous rend plus profondément humain, plus compétent et nous permet, à terme, d’être plus entier.»
Lorsque les effets de son traumatisme cérébral se sont estompés, Sarah Polley s’est appliquée à être plus attentive aux signaux envoyés par son corps – et à interroger son interprétation de ces signes. Y a-t-il un problème ou s’agit-il juste d’anxiété? Cet inconfort est-il vraiment inquiétant ou m’indique-t-il de creuser un peu plus?
Une femme pleine de projets
S’il existe un fil rouge dans la carrière de Sarah, c’est l’idée que la vérité peut être contradictoire. Cette notion s’applique à son long métrage de 2011, Take This Waltz, une romance troublante et ambiguë déguisée en lettre d’amour pour Toronto, ou à Les histoires qu’on raconte, son documentaire de 2012 encensé par la critique sur sa famille et ses origines floues. Mais cette idée est d’autant plus apparente dans les livres que Sarah Polley a choisi d’adapter.
À 17 ans, elle a entamé une campagne d’un an afin d’obtenir les droits du roman de Margaret Atwood Alias Grace, au sujet d’une jeune femme accusée de meurtre et dont le seul pouvoir réside dans son propre récit. (Son adaptation en série a finalement été diffusée sur CBC et Netflix en 2017.) Loin d’elle, son premier film en tant que réalisatrice, basé sur une nouvelle d’Alice Munro, puise dans les souvenirs que Sarah Polley conserve de sa grand-mère perdant la mémoire et de son père portant le deuil de sa femme. «Dans chacun de ces livres, quelque chose soulève une question que je ne peux pas même formuler mais qui me prend aux tripes», affirme-t-elle.
Pour son projet suivant, Ce qu’elles disent, c’est le livre qui est venu à elle. Frances McDormand, qui joue également dans le film, a acquis les droits du roman de Miriam Toews, basé sur des faits réels, et contacté Sarah Polley pour qu’elle le réalise. Ce succès international de librairie est centré sur un groupe de femmes mennonites qui apprennent que les hommes de leur colonie les agressent sexuellement durant la nuit avec l’aide de sédatifs pour animaux. Dans le livre, les femmes se rassemblent, s’emportent, pleurent et débattent de ce qu’elles feront ensuite.
La production de Ce qu’elles disent chevauchait le travail de Sarah sur Run Towards the Danger, et elle a découvert que ces deux projets se croisaient de manière inattendue. «Il y a un moment où le personnage d’Ona dit: “Pourrait-on, au lieu de débattre des avantages et inconvénients de rester et lutter, discuter de pourquoi nous nous battrions?” Le changement qu’elle propose – “Que tentez-vous de construire?” au lieu de “Que tentez-vous de détruire?” – est intéressant. Quelle voie emprunter pour surmonter un traumatisme, au lieu de se contenter de revisiter le passé ou de s’y immerger? Et maintenant? Et après?»
Dans Run Towards the Danger, Sarah Polley évoque certains de ses moments les plus sombres tout en se demandant comment s’en servir pour bâtir quelque chose de nouveau. À travers l’acte d’écrire et de réécrire, elle traite sa propre histoire de la même manière qu’elle aborde l’adaptation d’un livre: elle entre dans le récit et tente de répondre aux questions qui résonnent dans ses entrailles.
Lorsque l’on est ancré dans son passé ou guidé par une force que l’on ne veut pas contempler, selon Sarah, «une fois que l’on s’est laissé un peu brûler, on peut se transformer, devenir un être nouveau qui n’est pas dominé par cette force inconsciente. Je pense qu’il existe un avenir rempli d’espoir et presque cliché.»
La question demeure donc: Et maintenant? Et après?
Tiré de Sarah Liss, « Who Does Sarah Polley Think She Is? », The Walrus (17 mai 2022) © 2022, Sarah Liss. thewalrus.ca
Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!